Urgence climatique et inclusion des personnes handicapées : une bonne résolution à prendre pour 2025 ?


Le dérèglement climatique est un des grands défis du XXIème siècle, un sujet qui nous concerne tous et qui impose des changements importants dans nos sociétés. Si l’on a tendance à traiter séparément les différents enjeux sociaux et environnementaux, ceux-ci sont pourtant entrelacés : le dérèglement climatique accélère les migrations de population, les inégalités, la pauvreté… En ce sens, l’inclusion des personnes en situation de handicap est également un sujet à prendre en compte dans la lutte contre le dérèglement climatique. Dans un article scientifique publié en 2024 dans la revue Aequitas, les auteurs Sébastien Jodoin, Rose Paquet et Katherine Lofts explorent le rôle que peuvent jouer les droits des personnes en situation de handicap dans la lutte contre le dérèglement climatique. En cette nouvelle année 2025, nous vous proposons une lecture synthétique de cet article original, avec un sujet passionnant à l’intersection des missions sociales et environnementales portées par de nombreux acteurs publics et privés.
L’article se fonde sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) des Nations Unies, que nous avons déjà exploré lors d’un article précédent sur le modèle social du handicap. Ce cadre juridique impose aux États qui l’ont signé, soit 164 pays dont la France, de protéger ces droits dans tous les domaines, y compris dans les politiques climatiques. En résumé, la CIDPH conçoit le handicap comme une situation résultant de l’interaction entre les caractéristiques d’un individu et un environnement inadapté. Or, une telle conception appelle à la prise en compte des besoins d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans toute modification de l’espace physique, même lorsque celle-ci est liée à la transition écologique. Par exemple, la végétalisation de l’espace public, comme l’ajout d’arbres ou d’un mur végétalisé, doit se faire en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et des personnes déficientes visuelles dans leur déplacement.
Pourtant, une analyse approfondie des Contributions Déterminées au Niveau National (CDN) soumises dans le cadre de l’Accord de Paris révèle des lacunes criantes. En effet, sur 195 États membres, seuls 39 font référence, même de manière générale, aux personnes handicapées dans leurs stratégies climatiques. Parmi ces mentions, très peu proposent des mesures concrètes pour inclure ces populations dans les efforts d’atténuation ou d’adaptation au dérèglement climatique. Or, les CDN sont des outils cruciaux, car elles définissent les engagements climatiques de chaque pays. Mais dans la plupart des cas, les références aux personnes handicapées se limitent à reconnaître leur vulnérabilité accrue, sans détailler les solutions nécessaires. Par exemple, rares sont les pays qui collectent des données pour comprendre comment le changement climatique affecte spécifiquement les personnes en situation de handicap. Ainsi, cette invisibilisation pourrait avoir des conséquences dramatiques sur leur sécurité, leur santé et leur bien-être.
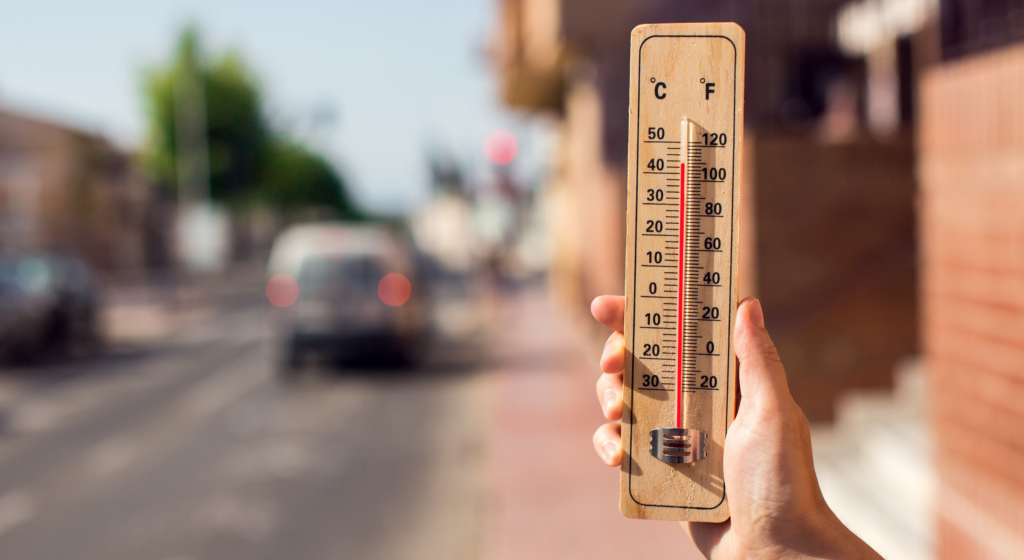


Les auteurs rappellent que les personnes handicapées sont particulièrement à risque en cas de catastrophes climatiques. Cela résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : l’inaccessibilité des infrastructures et des moyens de communication, le manque de dispositifs pour s’adapter ou fuir les zones à risques, la marginalisation dans les processus de décision… L’exclusion des personnes handicapées dans la préparation aux catastrophes climatiques a des conséquences souvent tragiques. L’article rappelle l’exemple de la Ville de New York, poursuivie en justice après les ouragans Sandy et Irène pour avoir négligé les besoins des personnes handicapées dans ses plans d’urgence.
En effet, la décision judiciaire a mis en évidence des lacunes graves, comme l’absence de moyens d’évacuation adaptés ou de refuges accessibles. Ce cas a conduit à une refonte des politiques locales, offrant un exemple de ce qui peut être accompli lorsque les droits des personnes handicapées sont pris en compte. Par ailleurs, allier inclusion et lutte contre l’urgence climatique ne profite pas seulement aux personnes en situation de handicap, mais améliore globalement l’expérience de tous les citoyens vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. Ainsi, les solutions inclusives, comme la conception d’infrastructures accessibles ou la participation active des personnes handicapées à la prise de décision, rendent les communautés plus résilientes et mieux préparées face aux crises.
Face à l’inaction des États, les personnes handicapées et leurs alliés se tournent de plus en plus vers les tribunaux pour utiliser le droit comme levier de transformation. L’article cite plusieurs exemples de litiges climatiques émergents qui lient droits humains et justice climatique. Parmi ces cas, l’affaire Mex M. c. Autriche est particulièrement significative. Un homme atteint de sclérose en plaques a porté plainte contre le gouvernement autrichien, arguant que son inaction climatique aggravait son état de santé et violait ses droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
Bien que la décision ne soit pas encore rendue, cette affaire met en lumière les risques pesant sur la santé des personnes en situation de handicap face aux changements climatiques. Des actions juridiques collectives peuvent également entraîner des transformations, comme celle menée par Environmental Justice Australia. Ce groupe, composé de jeunes, d’Autochtones et de personnes handicapées, a dénoncé le manque de mesures climatiques du gouvernement australien auprès des Nations Unies. En dehors de ces exemples, certains États se démarquent par des initiatives plus inclusives. Par exemple, le Zimbabwe, identifie explicitement les défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées dans ses politiques climatiques. Son plan national d’adaptation propose des mesures spécifiques, telles que la promotion de technologies accessibles et la simplification des informations météorologiques. Ces initiatives témoignent d’une volonté de combler les lacunes en matière d’équité climatique.
Toutefois, le Zimbabwe reste l’exception. En effet, la plupart des pays ne conçoivent pas des politiques adaptées aux besoins des personnes handicapées face à l’urgence climatique. Les auteurs soulignent que les gouvernements doivent aller au-delà des déclarations d’intention en développant des approches intersectionnelles qui tiennent compte des discriminations croisées liées au genre, à l’ethnicité, à la pauvreté et au handicap ; tous étant des facteurs d’accroissement des risques face aux potentielles catastrophes climatiques.
Alors que nous entrons en 2025, l’urgence climatique devient de plus en plus palpable dans notre quotidien. Cet article scientifique nous invite à construire des ponts entre les différents acteurs œuvrant pour un monde plus équitable et/ou respectueux de l’environnement. Des initiatives sociales peuvent bénéficier à l’environnement, et inversement. Par exemple, une démarche écologique incite à consommer local, ce qui appelle à la création d’emploi au sein du territoire. Pour bâtir un avenir durable, nous devons adopter une vision de la justice climatique qui inclut tous les membres de la société, sans exception. Investir dans des solutions inclusives n’est pas seulement une question de droits humains : c’est une stratégie indispensable pour faire face aux défis du XXIᵉ siècle.
Article rédigé par Dr Narcis Heraclide, responsable R&D.
Jodoin, S., Paquet, R., & Lofts, K. (2024). L’urgence climatique et les droits des personnes handicapées : état des lieux et perspectives. Aequitas, 30(1), 3–17. DOI: 10.7202/1112353ar.
Pour en savoir plus sur les services de Linklusion et le statut de Travailleur Indépendant Handicapé (TIH), rendez-vous sur notre FAQ